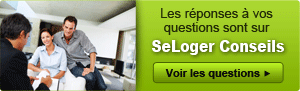Dossier de synthèse
La cession de créances professionnelles
Introduction du dossier de synthèse
Le crédit interentreprises est une pratique courante en France. Il permet au fournisseur d'octroyer à son client un avantage certain : une diminution de son besoin en fonds de roulement. Cette diminution permettra au client d'octroyer lui aussi des facilités de paiement à ses propres clients, ou de diminuer son endettement à court terme. Cette pratique s'étant généralisée, il est quasiment inconcevable de contracter sans octroyer des délais de paiement à sa clientèle : il ne s'agit donc plus aujourd'hui d'une faveur accordée à un client stratégique, mais un avantage « naturel » réclamé par tout cocontractant.
Ce faisant, cet avantage octroyé augmente le propre besoin en fonds de roulement du fournisseur. S'il dispose des financements, cela ne pose pas de problème ; mais ce cas est plutôt rare.
Le vendeur est donc contraint de rechercher des financements à court terme.
Si les besoins en trésorerie de l'entreprise sont ponctuels, et que le dirigeant ne souhaite pas être lié par un contrat à durée indéterminé avec une banque (comme par exemple dans le cadre de l'affacturage), qui ne lui serait que trop rarement utile, il peut opter pour la cession de créances. Cette opération consiste à vendre une ou plusieurs créances à une banque, qui en échange offre à l'entreprise le montant de cette créance, minoré de diverses commissions, et intérêts.
Le professionnel peut opter pour l'un des deux types de cession de créance suivants : celui de droit commun, ou celui réservé aux professionnels, dans le cadre de la loi Dailly.