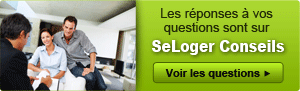Dossier de synthèse
La procédure devant les tribunaux de droit commun en matière civile
Sommaire  (cacher le sommaire)
(cacher le sommaire)
1. La procédure en l'absence d'incident
1. 1. L'introduction de l'instance
1) L'initiative du procès (article 54 et suivants du NCPC)
- L'assignation (article 55 et suivants du NCPC)
L'assignation est le principe pour toutes les juridictions.
Les articles 55 et suivants du NCPC prévoient l'assignation et ses modalités devant toutes les juridictions.
C'est « l'acte d'huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge ». Son objet est donc simple : la convocation de l'adversaire.
L'assignation est un peu particulière par rapport aux autres demandes car celle-ci est d'abord envoyée à l'adversaire avant d'être communiquée aux juridictions (mise au rôle).
L'assignation consiste à faire connaître à son adversaire :
- ses prétentions
- son argumentation
- ses demandes, les faits et pièces
L'assignation doit comporter les mentions obligatoires suivantes afin de bien informer son destinataire :
- Indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée (nature et siège),
- L'objet de la demande avec un exposé des moyens « en fait et en droit »,
- L'avertissement que faute de comparaître le défendeur s'expose à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre et sur les seuls éléments fournis par son adversaire,
- Indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
En l'absence de l'un de ses éléments, il ne s'agit pas d'une irrégularité de fond mais d'un vice de forme, ce qui suppose donc la présence d'un grief pour rendre l'acte nul. Cela signifie que, si l'une des mentions obligatoires venait à manquer dans l'assignation, celle-ci ne peut être annulée que si cela cause un réel préjudice à celui qui reçoit l'assignation. Elle ne sera pas annulée de plein droit.
En outre, l'assignation peut comporter des mentions complémentaires suivant la nature ou l'objet du litige. Par exemple, pour assigner devant le TGI (représentation obligatoire) il faudra mentionner le nom de l'avocat demandeur et stipuler que le défendeur doit constituer avocat et ce dans un délai de 15 jours (articles 752 et 755 du NCPC).
Il s'agit d'un acte d'huissier (qui est un officier public et ministériel dont la sphère géographique de compétence est limitée et pas absolue).
Elle doit être en français.
Il est possible d'assigner de façon rapide, au dernier moment pour stopper une procédure mais il faut toujours que l'assignation contienne une argumentation même si celle-ci est loin d'être définitive et devra être développée, retravaillée.
- Les Demandes portées directement devant le juge
- La Requête conjointe (article 57 du NCPC)
C'est l'acte commun par lequel les parties soumettent au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord et leurs moyens respectifs.
C'est ici un mode conventionnel d'introduction de l'instance, qui ressemble à une sorte d'arbitrage public.
Cette requête est utilisable pour tous les domaines mais elle est peu utilisée en pratique.
Cet acte introductif d'instance est rarement utilisé (sauf en matière de divorce) car il nécessite un certain état d'esprit, une volonté d'entente.
Elle doit comporter certaines mentions (identifications des parties, indication de la juridiction ) et, devant le TGI, les avocats constitués.
En matière de divorce, elle présente un intérêt pour les époux qui se sont entendus sur le résultat. Ce type de procédure permet de parvenir à une solution sans conflit, les époux établissent une sorte de convention que le juge homologue, valide. La requête conjointe permet alors un contrôle étatique afin que la convention ne contienne pas d'aberrations ni d'injustices.
- Requête et déclaration (article 58 du NCPC)
C'est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.
La requête introduit donc des procédures qui se déroulent à l'insu du défendeur alors que la déclaration suppose la convocation du défendeur par le tribunal et donc la reprise du contradictoire. Les mentions obligatoires sont les mêmes.
2) La saisine de la juridiction
- Modalités de la saisine
La saisine de la juridiction obéit à des modalités différentes selon la forme de la demande initiale.
Pour l'assignation et la requête conjointe, la demande initiale ne suffit pas pour saisir le juge, il faut également procéder à la mise au rôle de cet acte introductif d'instance au greffe de la juridiction (en pratique, cette mise au rôle s'effectue en remplissant un document appelé « placet d'enrôlement »).
Lorsque le procès doit se dérouler devant le Tribunal de grande Instance, la mise au rôle doit se faire dans les 4 mois suivant la délivrance de l'assignation sinon l'assignation est caduque et le procès est réputé ne jamais avoir existé, ce qui peut s'avérer très gênant au regard des règles de prescription. En effet, l'assignation étant interruptive de prescription, si elle devient caduque, le délai de prescription peut alors s'être écoulé et l'action sera alors irrecevable
- Conséquences de la saisine
Avec la saisine de la juridiction apparaît un nouvel acteur de la procédure: le greffe.
Ce dernier va effectuer deux missions :
- Il va inscrire l'affaire au répertoire général des affaires dont la juridiction est saisie. Le litige est alors enrôlé et l'affaire reçoit alors un numéro d'inscription.
- Il ouvre un dossier pour chaque affaire enrôlée : c'est le dossier auquel sera ajouté, tout au long de l'instance, les pièces de l'affaire. Ce sera lors en quelque sorte le témoin officiel du procès.